- ressources PROJET
- Glossaire
- personnalités
- U2D
- Sources
- inclassables
- biblio
- Podcast / vidéos
- architecture climatique
- Biodiversité végétalisation
- biorégion
- Dijon métropole
- Écoquartier
- Énergie
- îlots de chaleur urbains (ICU)
- Habiter la ville
- la rue
- Lois et normes
- Matériaux
- métabolisme urbain
- mobilité
- outils de simulation
- Paris
- Qgis
- Recherche
- réseaux
- RE2020
- Territoire empreinte
- UE union européenne
- Urbanprint / quartier
- UN United Nations
- urbanisme tactique
- ville active
- ville analogique
- ville chronotopique
- ville échelle humaine / désirable
- ville circulaire / métabolisme urbain
- ville créative
- ville décarbonée / post-carbone
- ville dense
- ville des enfants
- ville des proximités / du quart d'heure
- ville durable / adaptable
- ville fabricante
- ville inclusive
- ville intelligente / smartcity
- ville générique
- ville lowtech
- ville nature
- ville récréative
- ville résiliente
- ville santé et bien-être
- ville sobre / frugale
- ville stationnaire
- ZAN
- La place
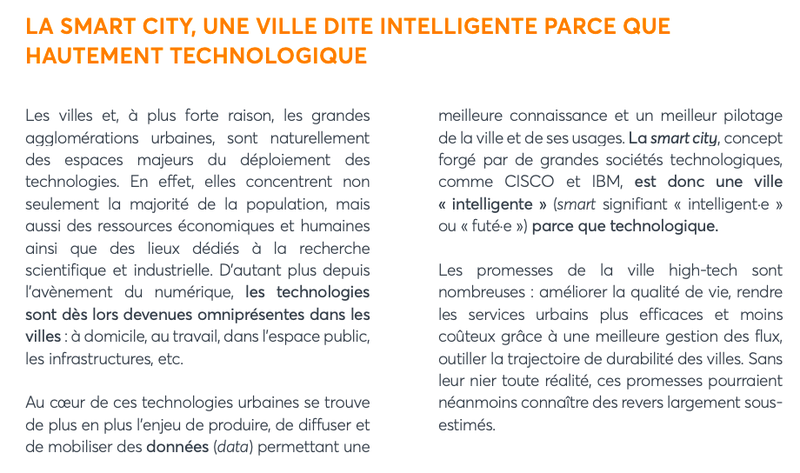
La smart city est née, à la fin de la décennie 2000, sous l’égide de grandes sociétés technologiques comme IBM ou Cisco, d’abord sur une promesse d’efficacité (et de modernité) des services publics. Après quelques années, le discours des consultants et des vendeurs de « solutions » a progressivement englobé la promesse environnementale : on allait être plus smart et (donc) plus green. Le renversement a été total lorsqu’à l’automne 2020, Stéphane Richard, PDG d’Orange à l’époque, a tenté de justifier le déploiement de la 5G en expliquant qu’elle allait être indispensable aux villes pour réaliser leur transition énergétique : pour être plus green, il faudra (forcément) être plus smart !
En vertu de quels arguments ? Les promesses restent génériques et bien vagues. Aujourd’hui, la 5G est là (et la 6G démarre… rendez-vous en 2030…), mais il est bien difficile de trouver des « cas d’usage » comportant des bénéfices indéniables pour l’environnement. La smart city n’a en fait pas grand-chose à voir avec l’environnement, il s’agit d’abord du déploiement de dispositifs technologiques de contrôle et de pilotage, comme dans les usines. Mais une ville n’est pas une usine, et un tel déploiement – si tant est qu’il soit réalisable, car dans le domaine urbain on affronte généralement le « déjà là », le patrimoine déjà construit depuis des siècles – n’aboutit pas nécessairement à une ville sympathique, accueillante… ou résiliente, si elle doit dépendre de la disponibilité de composants électroniques produits à l’autre bout du monde, de ressources rares, de l’opacité dans la conception des logiciels ou le stockage et l’utilisation des données collectées.
Quant aux promesses d’une efficacité toujours plus grande, on sait qu’on court toujours le risque d’un effet rebond, qu’elle ne serve pas à réduire les impacts, mais à consommer toujours plus : si la voiture autonome (encore hypothétique) permettait de fluidifier le trafic tout en bossant depuis son véhicule, les gens pourraient habiter encore plus loin de leur travail, cela inciterait à accroître l’étalement urbain et les distances à parcourir.
Il semble toutefois que, malgré tout le pouvoir d’attraction de la « nouveauté », les discours autour du numérique salvateur et le travail de marketing des industriels, la mode de la smart city soit en train de passer, au moins en Occident. L’abandon par SidewalkLabs (filiale du groupe Alphabet, la maison-mère de Google) du projet de la friche Quayside à Toronto au printemps 2020 a fait l’effet d’une douche froide (officiellement, le projet, qui avait provoqué l’enthousiasme à son lancement, a été abandonné pour des raisons financières, mais de vraies difficultés avaient surgi sur la possible marchandisation des données personnelles des futurs habitants). Il y a des effets de mode, comme partout : en ce moment, c’est l’IA qui tient la dragée haute, après le long-feu du métavers de Zuckerberg… Mais l’idée reste très implantée en Asie et au Moyen-Orient ; les projets délirants comme The Line, en Arabie Saoudite, sont obligatoirement smart, cela va sans dire (et forcément green, bien évidemment)
in bonpote
Et si la Smart City n’était que le dernier avatar en date de l’hygiénisme ? Après la ville haussmannienne, le rêve des cités-jardins, les utopies paternalistes, le déferlement des grands ensembles ou l’idéal pavillonnaire, nous avons subi les promesses de flux régulés par l’Intelligence Artificielle, de rues bardées de caméras et de poubelles connectées. L’urbanisme donne parfois l’impression d’être une suite de vaines tentatives pour mettre la ville au pas. Mais après avoir nourri les conférences et peuplé les salons professionnels, la Smart City semble à son tour s’étioler, sans avoir vraiment dépassé le statut de pépite marketing. Quand on peine encore à faire disparaître l’habitat indigne ou à réguler le stationnement des trottinettes, qui peut encore croire à une vie urbaine complètement régulée ? La Smart City est la somme d’une impasse écologique, d’un idéal de suroptimisation et de la tentation du contrôle social. La ville ne sera donc pas intelligente, et à défaut d’être bête, elle restera bordélique et inefficace. Quoi de plus complexe et de moins géré qu’une ville ? On se laisse bercer par l’idée que nos autorités locales pilotent ce vaste ensemble, mais à part quelques fondamentaux qui permettent à l’eau de couler dans nos robinets, aux écoles d’ouvrir et aux tramways de rouler, le reste est le fait de millions de décisions individuelles prises dans un fourmillement créatif et malheureux qui est le propre de la densité urbaine. Mais l’échec marketing de la Smart City ne dit pas que le numérique n’a rien changé à la ville.


